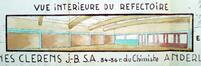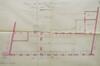Ancienne bonneterie Clérens, aujourd’hui centre d’entreprises Euclides
Rue du Chimiste 34-36
Typologie(s)
atelier (artisanat)
Intervenant(s)
K. A. D'HAVÉ – architecte – 1959-1960
Arthur D'HAVÉ – architecte – 1937-1960
Statut juridique
Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024
Styles
Modernisme
Inventaire(s)
- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)
- Le patrimoine monumental de la Belgique. Anderlecht-Cureghem (Archistory - 2017-2019)
Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)
- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).
- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.
- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).
- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.
- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.
Recherches et rédaction
2016, 2019
id
Urban : 34954
Description
Complexe modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. conçu par l’architecte Arthur D’Havé entre 1937 et 1960. Signatures sur
le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. de part et d’autre des entrées: «E. THOMAS / ENTR.
1937» et «A. D’HAVÉ ARCH. 1937» sur l’angle, «E. THOMAS
/ ENTR 1941» et «A. D’HAVE ARCH 1941» côté rue du Chimiste.
Historique
À l’angle de la rue du Chimiste et de la future rue des Mégissiers, alors rue de la Princesse, le mégissier, tanneur et maroquinier Sablon-Waltens fait ériger en 1869 un atelier de manipulation de peaux, implanté le long du cours de la Petite Senne. Trois ans plus tard, il se fait bâtir son habitation sur l’angle opposé (actuel no 37 rue du Chimiste), aujourd’hui remplacée par une salle de sport (Espace Lemmens). Repris dans les années 1920 par la Maison Clérens, spécialisée en bonneterie, le complexe compte, outre le vaste atelier, plusieurs hangars et une conciergerie, au centre de la parcelle. L’ensemble sera reconstruit en plusieurs phases à partir de 1937 par l’architecte Arthur D’Havé, secondé en 1959-1960 par K. A. D'Havé.
En 1937 est conçu le corps de quatre niveaux occupant l’angle, doté d’un pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. suivi de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. côté rue des Mégissiers. Conçu en 1939 et construit en 1941, le deuxième corps aligne neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. à front de la rue du Chimiste. En 1944, les bombardements des ponts sur le canal de Charleroi ayant ébranlé l’atelier de 1869, on en envisage la reconstruction, sans pour autant l’exécuter à l’époque. En 1947 est prévue l’implantation – non réalisée – d’une salle de réfectoire voûtée sur le toit du corps côté Chimiste. En 1952 est dressé un projet de transformation de l’ancienne conciergerie; celle-ci sera finalement démolie après 1971. En 1957, le complexe s’étend vers le nord par la construction d’un hangar d’un niveau sur le lit désormais désaffecté de la Petite Senne. La même année, la partie avant de l’atelier de 1869 est remplacée par un nouveau corps prolongeant celui de 1937. En 1959, c’est la partie arrière de l’atelier qui cède la place à un nouveau corps, accompagné d’un second, de moindre profondeur, qui clôt le complexe en carré. Ce dernier corps est doté d’un étage supplémentaire l’année suivante. En 1991-1992, le bureau d’architecture et d’urbanisme Hervé Gilson InternationalLe style international prône la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, du mur-rideau et des matériaux modernes comme le béton armé. Le terme style international est plutôt utilisé pour caractériser le modernisme d'après-guerre. présente un projet de transformation complète du complexe industriel en bureaux, qui ne sera pas réalisé comme tel. En 1994, les bâtiments, rénovés dans le respect de l’architecture d’origine, accueillent finalement le centre d’entreprises Euclides.
Description
Complexe composé de quatre corps implantés en carré autour d’une cour intérieure. Sous toit plat, corps de quatre niveaux, excepté l’intérieur, qui en compte cinq, les deux premiers de moindre hauteur. Bâtiments à ossature de béton armé formant portiquesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Façades en briques – rouges côté rues, peintes en blanc pour les autres –, rehaussées de pierre bleue pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. et les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de fenêtre. LinteauxÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. et pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. colossauxUn pilastre, une colonne ou un autre support est dit colossal lorsqu’il s’élève sur plusieurs niveaux ou sur la plus grande partie de la hauteur du bâtiment. délimitant les travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. en béton, à finition en «simili carrare» à l’origine côté rues. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. conservés, à multiples divisions, certains métalliques, d’autres en Cimarmé.
Façades vers chaque rue de respectivement neuf et dix travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les extrêmes plus étroites. Vers la rue du Chimiste, troisième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percée d’une haute entrée carrossable à encadrement de pierre et chasse-roues. Angle à trois pans de briques, les latéraux percés d’une entrée secondaire sous haute verrière éclairant la cage d’escalier. Dans l’axe, entrée principale en T, à encadrement ébrasé en pierre, sous auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. plat. Aux étages, tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. en retrait, qui devait à l’origine porter l’enseigne «BONNETERIE CLERENS». À l’extrémité rue des Mégissiers, pan de mur aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. à même tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau., masquant une cage d’ascenseur, accessible par une porte-haute. Porte principale remplacée, avec récupération des grilles.
Côté cour, corps longeant l’ancien lit de la Senne de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la première en décalage, percée à l’origine de «portes glissantes» à chaque niveau. Corps arrière de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la dernière d’un niveau supplémentaire, éclairant une cage d’escalier. Côté Senne, corps à rue doté d’une façade de briques rouges percée de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la centrale à balcons.
À l’intérieur, cage d’escalier principale en béton sur plan polygonal, à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. triangulaire. Côté Chimiste, deux premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. éclairant à l’origine sanitaires et bureaux. À l’arrière, cage d’escalier de plan carré autour d’un monte-chargeAscenseur destiné principalement au transport d’objets., coiffée d’un corps technique en toiture.
Historique
À l’angle de la rue du Chimiste et de la future rue des Mégissiers, alors rue de la Princesse, le mégissier, tanneur et maroquinier Sablon-Waltens fait ériger en 1869 un atelier de manipulation de peaux, implanté le long du cours de la Petite Senne. Trois ans plus tard, il se fait bâtir son habitation sur l’angle opposé (actuel no 37 rue du Chimiste), aujourd’hui remplacée par une salle de sport (Espace Lemmens). Repris dans les années 1920 par la Maison Clérens, spécialisée en bonneterie, le complexe compte, outre le vaste atelier, plusieurs hangars et une conciergerie, au centre de la parcelle. L’ensemble sera reconstruit en plusieurs phases à partir de 1937 par l’architecte Arthur D’Havé, secondé en 1959-1960 par K. A. D'Havé.
En 1937 est conçu le corps de quatre niveaux occupant l’angle, doté d’un pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. suivi de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. côté rue des Mégissiers. Conçu en 1939 et construit en 1941, le deuxième corps aligne neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. à front de la rue du Chimiste. En 1944, les bombardements des ponts sur le canal de Charleroi ayant ébranlé l’atelier de 1869, on en envisage la reconstruction, sans pour autant l’exécuter à l’époque. En 1947 est prévue l’implantation – non réalisée – d’une salle de réfectoire voûtée sur le toit du corps côté Chimiste. En 1952 est dressé un projet de transformation de l’ancienne conciergerie; celle-ci sera finalement démolie après 1971. En 1957, le complexe s’étend vers le nord par la construction d’un hangar d’un niveau sur le lit désormais désaffecté de la Petite Senne. La même année, la partie avant de l’atelier de 1869 est remplacée par un nouveau corps prolongeant celui de 1937. En 1959, c’est la partie arrière de l’atelier qui cède la place à un nouveau corps, accompagné d’un second, de moindre profondeur, qui clôt le complexe en carré. Ce dernier corps est doté d’un étage supplémentaire l’année suivante. En 1991-1992, le bureau d’architecture et d’urbanisme Hervé Gilson InternationalLe style international prône la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, du mur-rideau et des matériaux modernes comme le béton armé. Le terme style international est plutôt utilisé pour caractériser le modernisme d'après-guerre. présente un projet de transformation complète du complexe industriel en bureaux, qui ne sera pas réalisé comme tel. En 1994, les bâtiments, rénovés dans le respect de l’architecture d’origine, accueillent finalement le centre d’entreprises Euclides.
Description
Complexe composé de quatre corps implantés en carré autour d’une cour intérieure. Sous toit plat, corps de quatre niveaux, excepté l’intérieur, qui en compte cinq, les deux premiers de moindre hauteur. Bâtiments à ossature de béton armé formant portiquesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Façades en briques – rouges côté rues, peintes en blanc pour les autres –, rehaussées de pierre bleue pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. et les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de fenêtre. LinteauxÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. et pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. colossauxUn pilastre, une colonne ou un autre support est dit colossal lorsqu’il s’élève sur plusieurs niveaux ou sur la plus grande partie de la hauteur du bâtiment. délimitant les travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. en béton, à finition en «simili carrare» à l’origine côté rues. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. conservés, à multiples divisions, certains métalliques, d’autres en Cimarmé.
Façades vers chaque rue de respectivement neuf et dix travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les extrêmes plus étroites. Vers la rue du Chimiste, troisième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percée d’une haute entrée carrossable à encadrement de pierre et chasse-roues. Angle à trois pans de briques, les latéraux percés d’une entrée secondaire sous haute verrière éclairant la cage d’escalier. Dans l’axe, entrée principale en T, à encadrement ébrasé en pierre, sous auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. plat. Aux étages, tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. en retrait, qui devait à l’origine porter l’enseigne «BONNETERIE CLERENS». À l’extrémité rue des Mégissiers, pan de mur aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. à même tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau., masquant une cage d’ascenseur, accessible par une porte-haute. Porte principale remplacée, avec récupération des grilles.
Côté cour, corps longeant l’ancien lit de la Senne de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la première en décalage, percée à l’origine de «portes glissantes» à chaque niveau. Corps arrière de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la dernière d’un niveau supplémentaire, éclairant une cage d’escalier. Côté Senne, corps à rue doté d’une façade de briques rouges percée de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la centrale à balcons.
À l’intérieur, cage d’escalier principale en béton sur plan polygonal, à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. triangulaire. Côté Chimiste, deux premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. éclairant à l’origine sanitaires et bureaux. À l’arrière, cage d’escalier de plan carré autour d’un monte-chargeAscenseur destiné principalement au transport d’objets., coiffée d’un corps technique en toiture.
Sources
Archives
ACA/Urb. 111 (21.05.1869), 398 (14.05.1872), 29050 (04.05.1937), 29500 (19.10.1937), 30853 (04.08.1939), 31717 (15.02.1944), 32459 (14.01.1947), 35231 (15.01.1952), 38136 (05.02.1957), 38346 (13.06.1957), 39305 (07.04.1959), 39916 (05.04.1960), 47325bis (07.11.1991), 47381bis (28.04.1992).
Périodiques
Almanachs du Commerce et de l’Industrie, «Chimiste (rue du)», 1880, 1928.